La Révolution dans les usines
1917-1918
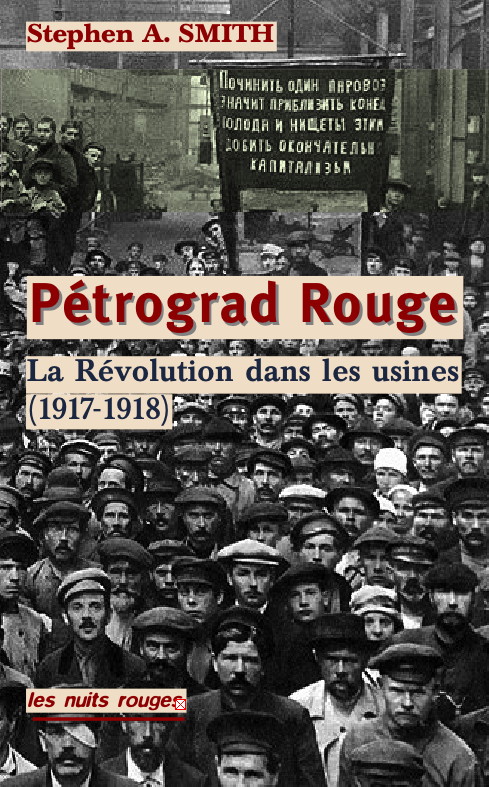
Il est paradoxal, au moment où nous célébrons le centième anniversaire de la révolution russe de 1917 (Février et Octobre) qu'il ait fallu attendre 65 ans environ pour que paraissent des ouvrages qui ont pour objet l'acteur principal de cette révolution, la classe ouvrière. Dans la foulée d'autres ouvrages principalement en langue anglaise, Steve Smith s'est intéressé à la classe ouvrière la plus concentrée de la Russie, celle de sa capitale Pétrograd. Quelle était donc cette classe ouvrière à qui échu le destin de lancer en février l'assaut contre le régime tsariste puis, tout au long de l'année, prendre confiance de plus en plus en elle, de se doter d'organes propres, les comités d'usine, de s‘affronter aux patrons bien sûr, mais aussi aux gouvernements, d'abord celui du prince Lvov et ensuite celui de Kerenski ?… (lire la suite)
Smith examine la structure des entreprises de Pétrograd par taille et type de production. Il y décrit les ouvriers qui y travaillent en détaillant leurs catégories, leurs origines, leur démographie, leur composition politique (qualifiés/semi qualifiés/non qualifiés, âge, formation, sexe, fraîchement urbanisé et conservant des liens forts avec la campagne ou enracinés dans la vie urbaine, ayant accès à la culture ou pas, militants de partis, etc.). Il se penche non seulement sur leurs conditions dans l'usine mais aussi à l'extérieur.
L'auteur fait l'état des lieux de la structure productive, suite au bouleversement gigantesque produit à partir de 1914. L'industrie russe est réorientée vers l'effort de Guerre en faisant la part belle aux usines mécaniques et chimiques. L'accroissement de la taille des unités de production (le « monstre » Poutilov passant ainsi de 13 000 à 30 000 ouvriers et nombre d'usines atteignent plus de 10 000 ouvriers) entraîne une modification en profondeur de la composition de classe. Les femmes — présentes avant-guerre principalement dans le textile — les jeunes voient leurs nombres augmentés dans les emplois non-qualifiés tandis que décroît la centralité des ouvriers qualifiés, accrochés à leurs métiers, remplacés par des ouvriers semi-qualifiés. Si les salaires augmentent, les conditions de travail empirent. Dans les usines militarisées, la répression règne. Smith décrit aussi les grèves menées avec ténacité qui ébranleront le régime tsariste. A partir de 1916, l'inflation galopante va ronger les augmentations de salaire cependant que le ravitaillement devient catastrophique et la pénurie alimentaire pointe sur fond d'effondrement de l'appareil productif, épuisé par la guerre.
C'est dans ces conditions qu'éclate la révolution de Février qui surprend les militants. Le tsar renversé, les ouvriers reprennent le chemin des usines mais avec un objectif précis : leur condition doit changer. De même que la révolution démocratique transforme la vie à l'extérieur, elle doit aussi transformer le travail. Très rapidement, les ouvriers créent des comités d'usine, d'abord dans les entreprises d'état, ensuite dans les grandes entreprises de la capitale et des autres centres industriels de Russie. Il y aura au total 244 comités d'usine, à Pétrograd, dans toutes les grandes entreprises.
Les revendications ouvrières portées par les comités sont simples : diminution du temps de travail (journée de huit heures), augmentations (souvent uniformes) des salaires, démission forcée des contremaîtres, des chefs grands et petits et des directeurs, bref de tous ceux qui se sont distingués par leur zèle anti-ouvrier. Mais les objectifs ne se limitent pas à ceux-ci. Les ouvriers exigent certes des meilleures conditions de travail, d'hygiène et de sécurité mais ils veulent également accéder à la culture (bibliothèques, spectacles, etc.). Les comités créent des commissions faisant preuve parfois d'un pointillisme procédurier. S'il n'est pas aboli, l'ordre capitaliste dans les usines est sérieusement remis en cause. Par la lutte, les ouvriers gagnent confiance en eux-mêmes.
Si une partie des patrons a été forcé à la signature, le 8 mars 1917, de l'accord sur les huit heures, la majorité d'entre eux se refuse à l'appliquer entraînant de nombreux nouveaux conflits. A leur constitution, la plupart des comités ne veulent pas gérer, ni contrôler les entreprises. Leur finalité initiale était uniquement de s'opposer aux effets de l'ordre capitaliste. Face à la crainte de lock-out, de sabotage patronal et de fermetures, ils sont par la suite amenés à s'enquérir du fonctionnement des usines en nommant des représentants élus aux conseils d'administration, en vérifiant les livres de compte et les carnets de commande. Ce sont les premiers pas du contrôle ouvrier rendus plus crédibles par la constitution d'organes de coercition: la « Garde rouge », mais dans une minorité de grosses usines seulement.
Les comités obtiendront que les heures passées en assemblée générale et au comité soient payées par l'entreprise. Mais la permanence des tâches (bien que les comités soient souvent soumis à réélection) fait que certains animateurs se détachent naturellement de la production et commencent, dans la durée, à devenir permanents. Ainsi, chez Poutilov, en octobre, pour 30 000 ouvriers, on comptait environ 400 ouvriers détachés de la production pour assurer les tâches du comité. Les animateurs des comités étaient, la plupart du temps, des ouvriers qualifiés.
Le succès rapide des comités tient (outre que ce soient des organes créés par les ouvriers eux-mêmes sur la base d'une participation volontaire du plus grand nombre) pour beaucoup à l'interdiction par le tsarisme de tout corps intermédiaire, d'organes de négociation, de syndicats. Créés pendant la révolution de 1905-1906, début 1917, les syndicats n'ont d'existence réelle que dans le chemin de fer, les imprimeries et dans quelques secteurs marginaux. Dans la métallurgie, ils ont quasiment disparu.
Début mars, les syndicats se recréent dans le textile et la métallurgie mais les adhésions progressent lentement. Les comités occupent tout l'espace politique au sein des usines. C'est pourquoi les syndicats privilégient la dimension territoriale ou de branche. Tous les partis politiques démocratiques et révolutionnaires intègrent les syndicats avec leurs militants. Au niveau des branches, ce sont, à ce stade, les menchéviques qui dominent. Leur essor va être favorisé par le ministre du travail de Kérenski, le menchévique Skobelev. Ce dernier leur donne la faculté de négocier des conventions collectives par branche et par région. Les ouvriers des entreprises adhèrent en bloc à la mise en place de cet ersatz de démocratie sociale. Le coup de pouce du gouvernement explique la hausse des effectifs syndicaux. Ils rentrent vite en compétition avec les comités d'usine. Les syndicats accusent ceux-ci de localisme. Une critique qui n'a cependant pas de fondement car, très vite, les comités se sont coordonnés par ville, puis par région et, enfin, à l'échelle de tout le pays. Les syndicats vont mener des grèves pour signer des contrats en juillet et en août 1917. Pendant les agitations pour le contrat de la métallurgie, le 22 juillet 1917, des jeunes ouvriers de chez Poutilov brisent des machines. Ce fut leur critique pratique du syndicalisme.
L'exaspération des ouvriers vis-à-vis des patrons et du gouvernement Kérenski croît à mesure de la généralisation et de la radicalisation de la guerre de classe. Les bolchéviques en tirent profit en renforçant leurs positions dans tous les organes électifs de la classe, les comités d'usine, les syndicats et les soviets. Après l'échec de l'offensive Broussilov (juillet 1917), l'armée se désagrège et les bolchéviques sortent gagnants de l'échec du putsch de Kornilov (septembre 1917) ; la situation est mûre.
Octobre déchaîne l'enthousiasme. Dans cet élan, en unifiant toutes ses composantes, la classe ouvrière se mue en un bloc politique. La multiplication d'initiatives et de luttes autonomes a nourri le parti bolchévique qui, en retour, dès l'adoption des thèses d‘avril, nourrit le mouvement. A Pétrograd, ses effectifs sont passés de 14 000 en avril, à 43 000 en octobre, aux 2/3 des ouvriers. Le parti bolchévique agrège l'avant-garde ouvrière et attire SR de gauche et anarchistes. Mais ce mouvement d'initiative ouvrière a atteint un sommet, va se stabiliser puis redescendra.
Les comités d'usine commencent, à partir de décembre, à atteindre la limite de leur capacité à contrôler les entreprises et la production car ils ont du mal à rallier techniciens et ingénieurs. Les quelques exemples d'autogestion capotent. En outre, les comités se révèlent incapables de se donner une stratégie unifiée.
Face à la proposition des syndicats — soutenue par les menchéviques et une partie des bolchéviques — d'absorber les comités d'usine, ceux-ci hésitent sur l'attitude à adopter sur leur propre devenir. Tandis qu'une majorité (bolchéviques de « gauche » et anarchistes principalement) veut préserver leur autonomie y compris, pour certains, en opposition aux syndicats, d'autres finissent par accepter de devenir l'échelon de base des syndicats.
Entre-temps, l'économie russe s'effondre sur pieds par manque de matières premières et de combustibles. Les commandes se font rares, et tout se délite. Dans ce cadre, le décret sur le contrôle ouvrier publié le 18 novembre 1917, reste lettre morte. La productivité du travail déjà en net repli baisse davantage en conséquence des contrôles mis en place par le décret.
La décomposition de la structure productive va s'accélérer dès l'annonce du cessez-le feu et, plus tard, après le traité de Brest-Litovsk. La reconversion de l'industrie de guerre en industrie civile rate et la classe ouvrière de Pétrograd se dissout : de 417 000 en février 1917, à 350 000 en novembre, les effectifs chutent à 200 000 en mars 1918, puis 135 000 en juin 1918, au moment de la nationalisation de toutes les entreprises et avant le début de la guerre civile déployée. Particulièrement touchées sont les industries mécaniques et chimiques. La majorité des ouvriers non-qualifiés quitte la ville et retourne à la campagne, pour les autres c'est le chômage non indemnisé.
A ceci s'ajoutent la pénurie alimentaire — la ration de pain « descend » à 150 grammes par jour en janvier 1918 — et les menaces de prise de la ville par l'Armée allemande. Les militants ouvriers, quelle que fut leur orientation politique, ne sont pas loin de l'épuisement.
Les comités se vident aussi de leurs membres car une partie de leurs dirigeants est aspirée par les organes du nouveau gouvernement, tant dans les organes en charge de l'économie, que les organes locaux d'administration ou encore les forces armées. Maintenant que la grande majorité des patrons a disparu, l'appel à l'état, au nouvel état en train de s'organiser, comme remède miracle à tous les problèmes, va devenir le leitmotiv de la plupart des comités, ainsi que la demande de nationalisation de toutes les entreprises. Une mesure, celle-ci, qui, au demeurant, n'était pas présente dans le programme des bolchéviques.
Le recul des comités convainc les bolchéviques de changer de cap à leur égard. Le parti privilégiera désormais les syndicats, qu'il contrôle complètement. Le premier congrès panrusse des syndicats, en janvier 1918, refuse que ces derniers soient indépendants du nouvel état, ce qui était prôné par les menchéviques. Dans la foulée, les comités d'usine voient leur autonomie réduite. Ils acceptent, à leur majorité, lors de leur dernière Conférence nationale (22 — 27 janvier 1918), de devenir l'échelon local de syndicats tout en espérant y batailler ferme. Pour restaurer la discipline d'usine, seul moyen identifié pour accroître la productivité du travail effondrée, le parti bolchévique au pouvoir remplace la direction collégiale des usines par la direction d'un seul. Le retour du salaire aux pièces sera généralisé et les qualifications seront reconnues et dûment rémunérées, s'éloignant d'un certain égalitarisme mis en avant en 1917.
L'unité de la classe, réalisée autour d'octobre, entre toutes ses composantes n'y résistera pas : les divisions renaissent entre ouvriers non-qualifiés et qualifiés, chômeurs — y compris les ouvriers démobilisés qui se retrouvent sur le marché du travail — et ceux qui sont encore en activité, entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, urbains de longue date et campagnards, sans parler des divisions politiques etc. Tout cela renforce l'arrêt du mouvement.
Après avoir donné l'assaut au ciel, le mouvement de l'« autonomie prolétarienne » en Russie atteint son apogée puis décline pour finalement disparaître à l'orée de la Guerre civile. Mais pouvait-il en être autrement ? Si certains secteurs de l'industrie russe de l'époque n'avaient rien à envier à celle des pays capitalistes les plus développés et la campagne comptait aussi, dans un contexte certes largement arriéré, des cultures céréalières mécanisées, la structure générale de l'économie russe ne permettait pas le début d'une phase transitoire au communisme. Une phase qui devrait être marquée par la fin de la circulation des marchandises, la suppression de l'argent et la construction d'un plan capable d'identifier, de sélectionner et de satisfaire progressivement les besoins d'une société s'auto-administrant et se libérant de l'état.
Le tsarisme qui, dans un premier temps et dans une certaine mesure, avait favorisé le développement capitaliste a fini par le brider en restreignant le marché libre et en étouffant purement et simplement tout conflit de classe et tout organe de collaboration de classe comme pouvaient le devenir les syndicats.
Fallait-il donc renoncer à la révolution d'octobre, comme le prétendaient les menchéviques ? Pas le moins du monde. La plasticité de l'économie russe pouvait et devait être cassée par une série d'assauts violents. Ce que les prolétaires et les paysans pauvres russes ont fait. Ce qui a manqué, soulignait Lénine et, avec lui, le parti bolchévique, est l'extension du processus révolutionnaire aux pays capitalistes plus développés, Allemagne en tête. La classe ouvrière en Russie a sonné la charge mais les divisions prolétariennes d'Europe occidentale n'ont pas su lancer l'assaut à leur tour, dans le cadre d'une stratégie révolutionnaire coordonnée et articulée.
Par son travail patient et méticuleux d'enquête et d'analyse, Smith permet à chacun de se forger son opinion sur les événements sans tomber dans les simplifications mensongères d'une classe ouvrière toujours homogène et à l'offensive ainsi que d'un Parti bolchévique conçu tel un monolithe omniscient paré de toutes les vertus ou, symétriquement, de tous les vices.
Du Comité d'usine à l'Assemblée régionale
Vénétie, 1960-80

Après la Fiat et la Magneti Marelli, voici la chronique d'une troisième figure de l'autonomie ouvrère italienne : le Comité de la Montedison à Porto Marghera (près de Venise), monté avec l'aide du groupe Potere Operaio, qui se transformera en Assemblée ouvrière à partir de novembre 1972 et étendra son influence à une partie de la Vénétie. Des revendications identiqes à celle des autres comités ouvriers de l'époque apparaissent ici (augmentations uniformes, et même inversemment proportionnelles à l'échelle des salaires, réduction des cadences), portées par les mêmes méthodes de lutte (assemblées d'atelier puis d'usine, cortèges internes, refus de la délégation) et prolongées par des interventions extérieures sur les questions de logement, de transport, et, déjà, des nuisances chimiques dont pâtit, outre les employés de la grande usine chimique, toute la région. Écrite par certains de ses acteurs mèmes, la « mémoire ouvrière » n'est ici ni une élégie funèbre ni un ressassement nostalgique mais un encouragement à combattre aujourd'hui, et à vaincre.
Devi Sachetto, Gianni Sbrogiò, Les nuits rouges, 2012, 19 euros. Paru précédemment en italien chez Manifestolibri, Rome, 2009.Histoire du Comité ouvrier de la Magneti Marelli
Milan, 1975-78

Dans une grande usine milanaise, la Magneti Marelli, plusieurs dizaines de salariés s'organisent au milieu des années 1970 contre la direction et les syndicats dans un Comité politique ouvrier. Bientôt, cette « Garde rouge » comptera plusieurs centaines d'ouvriers (sur les 5000 de l'usine) — soit une force équivalente à celle du PCI — et sera en mesure d'imposer l'arrêt des mesures de restructuration (licenciements, délocalisation). Ce Comité ouvrier ne reste pas cantonné dans les murs de l'usine et participe aux autres luttes, grèves, manifestations, nombreuses à l'époque en Lombardie et dans toute l'Italie, et notamment à cette manière radicale de combattre l'inflation : les « autoréductions ». La Magneti Marelli ne fut pas la seule usine italienne à connaître des organes autonomes ouvriers, mais c'est son Comité qui a servi de référence à tous les autres, à la fois par ses initiatives propres et par sa capacité à faire profiter de son expérience les ouvriers des petites entreprises environnantes. Ce combat exemplaire s'inscrit dans le cours de cette tentative révolutionnaire des années 1968-1979, qu'il importe de défendre contre les falsifications et les calomnies qui l'accablent, et d'en tirer toutes les leçons qui s'imposent.
Emilio Mentasti, Les nuits rouges, 2009, 14 euros. Paru précédemment en italien chez Colibri, Paderno Dugano, 2000.Un ouvrier en lutte à l'usine FIAT Mirafiori en 1969.
La FIAT aux mains des ouvriers
L'automne chaud de 1969 à Turin

Ce livre retrace et analyse les mouvements de grève sauvage d'OS des usines FIAT, dont celles de Mirafiori, pendant l'année 1969 (de mai à décembre) en replaçant ce conflit dans une vague de rébellion qui a secoué l'Italie pendant une dizaine d'années : des usines aux universités, des quartiers populaires aux collèges, cette secousse sociale et politique repose sur des mouvements de grève le plus souvent sauvages et très durs, mais aussi sur un mouvement d'auto-réduction des loyers et des prix.
Les jeunes OS non qualifiés et venus du Sud se lancent massivement dans la lutte, en réaction à des conditions salariales et de travail particulièrement dures. Ils vont imposer leurs propres revendications (augmentations uniformes, passage de la catégorie pour tous, contrôle des cadences, parité d'avantages avec les employés, samedi férié, etc.) et modalités de lutte (grèves sauvages tournantes, blocages de la production, cortèges internes pour « nettoyer » les ateliers réticents à entrer en lutte, humiliation des chefs contraints d'ouvrir ces cortèges internes en brandissant le drapeau rouge…), en association avec des militants étudiants ou extérieurs d'autres usines, venus au départ les rencontrer aux portes de l'usine pour former ensuite, ensemble, une assemblée ouvriers-étudiants qui signera ses tracts par Lotta Continua. Cette assemblée présentera ce cas unique dans le monde où de 500 à 1 000 ouvriers se réunissaient quotidiennement, après le travail, pour discuter des actions et en préparer d'autres et, pendant un moment, ont pu contester le pouvoir des syndicats sur la direction des luttes et poser la question de la révolution.
Face à cette déferlante, les syndicats débordés vont profiter des vacances pour faire leur auto-critique et accepter, bon gré malgré, les revendications d'abord puis les formes de luttes ensuite des grévistes. Ils vont bénéficier de deux avantages. Premièrement, à l'automne s'ouvre le renouvellement tri annuel des conventions collectives nationales de toutes les branches qui doivent être signées avant décembre 1969. Le syndicats vont donc pouvoir organiser des journées de grève nationales pour épuiser préventivement la combativité ouvrière et en donner le rythme. Deuxièmement, une majorité d'ouvriers veulent consolider les acquis de juin, et préfèrent s'appuyer sur les délégués par opposition à la minorité qui y répondra par le slogan « Nous sommes tous des délégués.»
Un livre à lire donc qui tant dans la description que l'analyse permet à tous de se faire une idée de la richesse de ce mouvement et des questions qu'il a soulevées d'autant que les questions concrètes posées par la lutte de cette époque (délégation ou pas, avant-garde à un moment mais pas à un autre, etc.) n'ont été résolues ni hier ni encore aujourd'hui…
Diego Giachetti, Marco Scavino, Les nuits rouges, 2005, 14 euros. Paru précédemment en italien chez BFS Edizioni, Pise 1999.